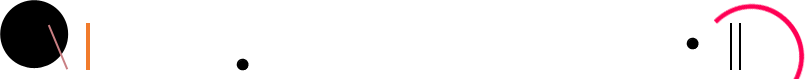- ataille de caractère -
- Ataille de caractère +
- imprimerimprimer la page
- version pdfversion pdf de la page
Saison passées | saison 2016 - 2017
Orchestre, chœurs et solistes du CNSMD de Lyon
Saison symphonique
Dimanche 4 décembre
16:00 -
Auditorium de Lyon
149 rue Garibaldi
Lyon 3e
Gratuit
Réservations à partir du 04/11
Auditorium-lyon.com
Tél. 04 78 95 95 95
François-Xavier Roth, direction
Solistes des classes de chant du CNSMD
Natasha Sallès, soprano
Séraphine Cotrez, alto
Quentin Desgeorges, ténor
Yaxiang Lu, basse
Classe de direction de chœurs :
Luping Dong & Tanguy Bouvet, direction (Bruckner)
Nicole Corti, préparation musicale
Chœurs : classe de direction de chœurs, ensemble vocal et chœur atelier du CNSMD de Lyon
Avec la participation de Spirito-Jeune Chœur symphonique
Nicole Corti, chef de chœurs
Maîtrise de la Primatiale Saint-Jean
Thibaut Louppe, préparation musicale du chœur d’enfants
Anton Bruckner
Motets a cappella (Ave Maria ; Graduel Locus iste, Os justi, Christus factus est ; Vexilla regis, Virga jesse)
Gilbert Amy
Missa cum jubilo pour quatuor vocal, chœur d’enfants ad libitum, chœur mixte et orchestre
Missa cum jubilo – Gilbert Amy
pour quatuor vocal, chœur d’enfants ad libitum, chœur mixte et orchestre.
Composition : de 1981 à 1983. Création : Salle Pleyel, le 26 mai 1988, par l’Orchestre de Paris.
Composée entre 1981 et 1983, la Missa cum jubilo de Gilbert Amy (né en 1936) est l’une des œuvres les plus importantes du compositeur. Importante du fait de l’effectif requis (quatuor vocal, chœur d’enfants ad libitum, chœur mixte et orchestre conséquent) et sa durée (environ une heure). Importante également étant donnée la singularité du genre musical choisi, une messe, alors même que l’œuvre sacrée est peu présente dans la production de Gilbert Amy si l’on excepte Shim’anim Sha’ananim (1979) ou plus récemment les Litanies pour Ronchamp (2005). Mis à part quelques œuvres isolées, le genre de la messe, s’appuyant sur les textes liturgiques de l’ordinaire de la messe, est quasiment inexistant après 1945 (il convient toutefois de citer la Messe d’Igor Stravinsky (1948), celles de Hindemith (1963), de Bernstein (1971) d’Ohana (1977) ou encore la Messe « Cum Jubilo » (1966) de Maurice Duruflé.
A propos de cette œuvre, Gilbert Amy indique :
Quelle est la place de la réflexion personnelle, donc de la foi, dans la démarche ? A la question posée : « Est-ce qu’on a besoin d’être croyant pour écrire une messe ? Est-ce que ça aide ? Est-ce que ça n’aide pas, etc. ? », je crois qu’on peut donner une réponse plurielle. Je crois que les besoins en matière d’art sont toujours complexes ; ils ne peuvent pas s’exprimer d’une seule manière. Il y avait sans doutes une nécessité, à une période de ma vie, de faire le point sur les questions de la religion, de voir comment je recevais la religion et ce qui me restait de la religion de mon enfance.[1]
Au début des années 80, l’engagement du compositeur est donc total, et ne va pas de soi pour un musicien dont une large partie du langage musical est influencé, au départ, par le cercle et les esthétiques avant-gardistes de Darmstadt (pratique du sérialisme, de l’œuvre ouverte…). De même, écrire « dans la ligne des grandes messes symphoniques » invite naturellement le compositeur et le public à situer cette œuvre dans un réseau et une perspective historique qui n’ignore pas l’héritage des maîtres (de Machaut à Stravinsky en passant par Beethoven pour ne citer qu’eux). A Machaut, Amy emprunte la technique de l’isorythmie, à Beethoven, la grande forme et la durée (la Missa Solemnis dure environ une heure et demie), à Stravinsky l’effectif instrumental de la Symphonie de Psaumes (1930), caractérisé par le rôle important des instruments à vents, ainsi que par l’absence de violons et d’altos aux cordes.
Un autre élément qui caractérise la Missa cum jubilo est son caractère non-liturgique. Sur ce point, Gilbert Amy est très précis : On m’a posé la question : « Pourquoi ne tenez-vous pas à ce que votre messe soit donnée dans une église ? ». J’ai dit qu’elle doit d’abord être lisible, elle doit être compréhensible, elle doit être audible. Pour cela il faut donc que les conditions de logistique acoustique soient réunies. (…) Il sera plus difficile de percevoir tous les détails qui impliquent une acoustique appropriée. C’est pour cela que je n’ai aucune espèce de complexe de dire qu’effectivement le concert est le meilleur endroit.[2]
Ainsi à travers les différents moments de la Missa cum jubilo, (conservés ici dans l’ordre traditionnel d’exécution : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei), quiconque a déjà entendu la musique de Gilbert Amy reconnaitra des caractéristiques de son langage et comprendra que cette œuvre synthétise des problématiques chères au compositeur. Parmi celles-ci, le soucis accordé à la voix et l’aspect éminemment dramatique du texte rappelle les pièces pour voix et orchestre (Œil de Fumée (1957), Strophe (1966), D’un espace déployé (1973)… De même, l’écriture qui fonctionne sur des principes d’oppositions et d’antagonismes à plusieurs niveaux, avec un soucis permanent accordé à la dimension spatiale de l’orchestre, évoque la place importante accordée à cet instrument (Chant (1968) Orchesthral (1989), Trois Scènes (1995) …), ainsi que son éminente carrière de chef d’orchestre (Gilbert Amy fût le successeur de Pierre Boulez à la direction du Domaine Musical ainsi que le fondateur en 1976 du Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio-France).
Créée le 26 mai 1988 à la Salle Pleyel, la Missa cum jubilo reçut un accueil favorable de la part du public et de la presse. Une oreille attentive se souvient :
Hambourg, le 26.02.90
Cher Gilbert,
Je suis très impressionné par ta Messe. Une œuvre de grande beauté et de dramatisme intérieur. Les deux moments avec les cloches sont extrêmement beaux et tendre (…) ton style est original et individuel (et ce que j’aime: indépendant de l’avant-garde ainsi que du rétro.) (…)
De ton György [3]
Motets a cappella – Anton Bruckner
Ave Maria (1861) ; Locus iste (1869) ; Os justi (1879) ; Christus factus est (1884) ; Virga jesse (1885) ; Vexilla regis (1892).
Au cours de sa vie, Anton Bruckner (1824-1896) ne compose pas moins de quarante motets. De Pange lingua (1835/1836) composé à onze ans alors qu’il étudiait la musique auprès de Johann Baptist Weiß à Hörsching à l’ultime Vexilla regis (1892), ce genre musical occupe une place privilégiée dans l’œuvre sacrée du compositeur. Pange lingua est d’ailleurs remarquable puisque cette œuvre, composée à l’aube de la vie du musicien, se voit révisée par lui-même dans ses dernières années d’existence. Preuve s’il en est de l’importance que revêtait ce genre musical dans l’œuvre du « grand musicien d’église de l’époque romantique »[1]
Œuvre vocale polyphonique, la forme du motet naît dans les années 1220 et se développe particulièrement au XIVe siècle sous l’impulsion des musicien de l’Ars Nova (Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut…) qui se saisissent des potentialités et de la plasticité remarquable de ce genre musical pour mettre en musique des textes liturgiques et profanes. Bien qu’originellement a cappella, les motets des XVIIe et XVIIIe siècles sont « augmentés » de parties instrumentales de plus en plus fournies afin de soutenir l’expression littérale. Genre protéiforme, le motet du XIXe siècle dans les pays germaniques tend à retrouver une certaine idée de la pureté et de quintessence en revenant à la forme a cappella dont Mendelssohn, Liszt, Brahms et Bruckner sont les figures majeures.
Descendant d’une famille d’instituteurs et de musiciens (son père embrassait lui-même la triple fonction de chef de chœur, organiste et sacristain), Anton Bruckner baigne depuis sa plus tendre enfance dans la musique, et en particulier dans la musique liturgique. Outre les messes dominicales qui lui laissèrent une grande impression, le jeune garçon devient chantre à l’âge de 13 ans à l’Augustiner Chorherren-Stift (Ecole de l’Abbaye) de Saint-Florian. C’est à cette période que le compositeur fît la découverte du répertoire des compositeurs religieux de son époque, particulièrement la sonorité du chœur a cappella ainsi que celle de l’orgue (celui de l’abbaye était le second plus grand orgue de la Haute-Autriche, après celui de Linz, la capitale du Land).
Témoignant de l’évolution créatrice du compositeur, les motets d’Anton Bruckner tiennent leur spécificité de l’équilibre trouvé entre une esthétique proche du mouvement cécilien (qui entendait retrouver une certaine ascèse de la musique liturgique en retournant à une écriture proche de celle pratiquée à la Renaissance) et un langage ancré dans le post-romantisme de par ses libertés harmoniques. L’ombre de deux géants plane donc sur ces œuvres, d’un côté une certaine idée de la perfection et de l’atemporalité héritée des consonances de Palestrina, de l’autre les tensions et les dissonances modernes de Wagner.
L’Ave Maria (1861) pour chœur à sept parties a cappella, premier chef–d’œuvre de maturité du compositeur, évoque déjà ce compromis entre deux esthétiques opposées. Si l’évidence d’une forme qui se déploie selon les différents versets ainsi que le caractère antiphonique (opposition des voix d’hommes et de femmes) tendent vers le langage angélique et atemporel du contrepoint palestrinien, certaines séquences et mots sont l’objet de chromatismes et de modulations harmoniques qui sonnent comme une signature temporelle, un rappel de la contemporanéité du geste musical.
Graduel romain, Locus Iste est la première œuvre religieuse de la période viennoise de Bruckner. Créé le 29 octobre 1869, en plein air, sur le parvis de la cathédrale Saint-Etienne, ce motet est probablement un des plus populaires du compositeur et la plus célèbre mise en musique du texte sacré (Locus iste a Deo factus est « Ce lieu a été fait par Dieu »). Dans la tonalité lumineuse d’ut majeur, le rôle prédominant des basses et la stabilité de l’écriture homophonique dans la première partie du motet (reprise à la fin), donnent à l’ensemble l’impression d’une solidité de la maison de Dieu tandis que la partie centrale en si majeur où les basses se font plus discrètes au profit d’inflexions aériennes (le point culminant étant le fa# au soprano), résonne comme l’évocation du sommet d’un clocher, lien infime qui relie la terre au ciel.
Composés à six ans d’intervalle Os justi (1879) et Christus factus est (1884) sont deux motets de pleine maturité du compositeur. Si le graduel Os justi est certainement le motet le plus archaïsant de Bruckner (mode ecclésiastique lydien, parallélisme des voix, antiphonie, alternance de passage homophoniques et contrapuntique qui font alterner psalmodie et jubilus), il en est tout autrement de Christus factus est qui penche plutôt vers des audaces harmoniques que n’aurait pas renié Liszt. Le musicologue Jean-Yves Bras voit dans ce motet, parmi les plus expressifs du compositeur, de nombreux symboles religieux, à commencer par les entrées fuguées de la seconde partie où les quatre voix pourraient bien représenter les « quatre directions du Christ en croix » avec trois voix principales (symbole de la Trinité) conduisant à l’exaltation de certains termes (par exemple sur « super omne nomen »).
Virga jesse (1885), destiné à célébrer le centenaire du diocèse de Linz, partage avec Christus factus est la même veine expressive et chromatique et fût un succès auprès du public qui ne cessera de considérer Bruckner comme « l’un des plus grands inventeurs musicaux et contrapuntistes, mais aussi un très noble héritier intellectuel de Wagner comme de Beethoven, et en particulier l’un des géniaux compositeurs de symphonies et de musique religieuse » (Deutsche Zeitung, 13 octobre 1896).
Vexilla regis (1892) est l’ultime œuvre de musique sacrée du compositeur avant le Psaume CVX composé la même année. Ce motet, qui prend des allures d’hymne, semble un lointain hommage à la musique liturgique de Monteverdi. Composé dans le mode phrygien (mode de mi), il associe, lui aussi, audaces harmoniques et modulations abruptes qui évoquent l’usage des fausses relations chères aux compositeurs de la Renaissance et de la première moitié du XVIIe siècle.
A nouveau, la symbolique du chiffre trois est présente dans la partition, que ce soit dans la reprise, musicalement à l’identique, des strophes 1, 6 et 7 de l’hymne romain de Venantius Fortunatus ou encore dans la présence de l’Amen de Dresde (motif mélodique entonné sur le mot « Amen » à la messe, utilisé en Saxe depuis le début du XIXe siècle) sur des termes significatifs: « prodeunt », « unica » et … « trinitas » !
Max Dozolme, étudiant du département de culture musicale
du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon
[1] La Musique Romantique (1959), Alfred Einstein.